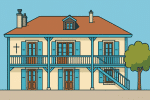Peut-on vraiment dé-finir l’Infini, si définir signifie lui mettre une limite ?

Ce lexique est vivant, en perpétuelle évolution. Il se transforme au fil de vos questions et de la recherche commune à la Maison bleu ciel.
Les définitions proposées ici ne sont pas des vérités figées, mais des pistes, des invitations à explorer, à questionner, à reformuler. Provisoires, elles ouvrent un chemin, offrent des repères sans enfermer, éclairent sans figer le mystère. Si elles ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté. Et si elles vous inspirent d’autres mots, d’autres formulations, suivez cet élan : c’est dans cette dynamique que ce lexique prend tout son sens.
Dans le domaine spirituel, les mots balbutient souvent. Ils ne sont que des éclats, des tentatives imparfaites pour pointer vers l’Indicible. Et au fil du temps, ils ont accumulé des couches, des interprétations, des rigidités qui les éloignent de leur source vive.
Les mots doivent être lavés pour retrouver leur limpidité. Ils ne prennent leur véritable sens que lorsqu’ils sont réaccordés à l’expérience, à la présence, à la résonance intime avec l’Essentiel. Ici, nous ne cherchons pas tant à les définir qu’à les laisser respirer à nouveau, à les délester de ce qui les alourdit pour qu’ils puissent redevenir ce qu’ils sont : des portes ouvertes vers l’Infini.
Tout le lexique

m
- Mal Le mal, dans une lecture non-duelle, n’est pas une force opposée au bien, ni un principe absolu. Il n’est pas une puissance extérieure qui s’acharne contre nous, mais ce qui nous divise, ce qui nous éloigne de l’Unité. Le mal se manifeste chaque fois que nous nous enfermons dans la peur, la séparation, la violence intérieure. Il n’est pas une fatalité, mais un état que nous pouvons traverser, transformer, illuminer. Dans la prière Délivre-nous du mal, il ne s’agit pas d’échapper à une force obscure, mais de retrouver l’espace de liberté et de clarté où l’Essentiel circule en nous.
- manteau Le manteau est ce qui couvre ou ce qui se dépose. Il peut être une protection, une enveloppe qui réchauffe et abrite, mais il peut aussi être ce qui nous alourdit, un poids que l’on porte et que l’on est appelé-e à déposer. Dans la Bible, le manteau est souvent un signe d’identité et de transmission. Élie jette son manteau sur Élisée (1 Rois 19,19) pour lui transmettre sa mission. Bartimée, l’aveugle, laisse tomber son manteau avant de rejoindre Jésus (Marc 10,50), signe qu’il abandonne l’ancien pour entrer dans une nouvelle vision. Nous avons tous des manteaux intérieurs : des rôles, des attachements, des protections que nous croyons nécessaires. Mais certains finissent par peser plus qu’ils ne protègent. Quand vient le moment, il faut oser les lâcher. Revêtir un manteau peut signifier recevoir un appel, une responsabilité. Le déposer, c’est oser la nudité intérieure, ne plus s’accrocher à ce qui n’est plus nécessaire. Qu’avons-nous besoin de revêtir aujourd’hui ? Et quel manteau sommes-nous prêt-e-s à laisser derrière nous ?
- Marie Marie (Maryam de Nazareth) n’est pas seulement la mère de Jésus, elle est celle qui dit oui sans tout comprendre, non par naïveté, mais par une confiance qui dépasse le mental. A l'ange qui vient lui annoncer qu'elle va être enceinte, elle répond "Qu’il me soit fait selon ta parole" (Luc 1,38). Ce n’est pas une soumission passive, mais une ouverture intérieure totale, un consentement à laisser l’Infini naître en elle. Elle est l’espace de virginité en nous, ce lieu intérieur où rien n’est pris, où rien n’est possédé, où l’Essentiel peut advenir sans obstacle. C’est dans cette vacuité vivante que l’Infini prend chair, que la Présence s’incarne. Marie ne garde pas son fils pour elle : elle l’accompagne jusqu’au bout, elle l’offre au monde, puis elle s’efface, laissant place à l’Ouvert. Elle est l’image de l’accueil, de la disponibilité à ce qui cherche à naître en nous. Nous avons tou-te-s devant nous un devenir de virginité : un chemin vers cette transparence où la Vie peut se donner librement.
- Marie-Madeleine Marie-Madeleine est la disciple du passage, celle qui traverse toutes les frontières : du rejet à l’accueil, de la nuit à la lumière, de la mort à la vie. Elle est la première à voir le Ressuscité, non parce qu’elle aurait été parfaite, mais parce qu’elle a osé aimer jusqu’au bout. Elle est cette part en nous qui cherche sans relâche, qui va au bout de l’amour, qui ose la vulnérabilité. Elle est aussi celle qui doit apprendre à ne pas retenir : "Ne me retiens pas." dit Jésus (Jean 20,17). Car l’amour véritable ne possède pas, il libère.
- Marie (sœur de Marthe) Marie est celle qui, au lieu de s’agiter, s’assied aux pieds de Jésus et l’écoute en silence (Luc 10,39). Elle incarne l’ouverture, la disponibilité, l’abandon à l’instant présent. Elle est cette part en nous qui sait s’arrêter, qui laisse tomber l’urgence pour entrer dans une écoute profonde. Elle ne cherche pas à faire, mais à être. Elle ne s’inquiète pas de ce qui doit être accompli, elle se tient simplement dans l’accueil du Vivant. Jésus dit qu’elle a choisi "la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée" (Luc 10,42). Non pas parce que l’action de Marthe serait inutile, mais parce que tout service prend racine dans une présence intérieure. Marie nous rappelle que l’essentiel ne se saisit pas par l’effort, mais se reçoit. Elle nous invite à entrer dans une qualité d’écoute où l’Infini peut se dire, sans agitation, sans attente, juste dans le silence d’un cœur offert.
- Marthe Marthe est celle qui accueille Jésus chez elle, qui s’affaire pour bien faire, qui veut que tout soit en ordre. Elle représente l’élan du service, l’attention aux tâches concrètes, la volonté d’agir. Mais elle est aussi celle qui s’inquiète, qui se charge de trop, qui se laisse absorber par l’action au point d’en oublier l’essentiel. Jésus lui dit : "Tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire." (Luc 10,41-42). Marthe est cette part en nous qui veut bien faire, qui cherche à répondre aux attentes, qui s’active sans cesse. Elle est précieuse, car sans elle, rien ne se mettrait en place. Mais elle a besoin de se poser, d’apprendre à laisser l’Être précéder le faire. Loin d’opposer action et contemplation, Marthe nous invite à unifier les deux : servir, oui, mais sans se perdre dans l’agitation ; être pleinement dans le monde, mais sans oublier l’Ouvert.
- Matthieu Matthieu est celui qui passe de l’accumulation à l’offrande. Collecteur d’impôts, il vit du calcul et de la possession, mais il laisse tout derrière lui pour suivre un autre chemin. Son passage illustre un basculement : de la comptabilité du monde à la gratuité du Royaume. Il montre que l’appel de l’Essentiel peut toucher n’importe qui, même celui ou celle que l’on croyait perdu-e dans des logiques d’intérêt. Il est cette part en nous qui cherche d’abord la sécurité, l’accumulation, mais qui, un jour, perçoit qu’une autre richesse est possible. Il symbolise le passage du contrôle à l’abandon, du marchandage au don, de la peur du manque à la confiance dans la Vie.
- méditation La méditation n’est pas une technique pour atteindre un état particulier, ni un effort pour maîtriser l’esprit. Elle est une présence simple et nue à ce qui est, sans vouloir retenir, contrôler ou fuir. Une disponibilité intérieure à l’instant, à soi, à la vie. Dans la tradition biblique, méditer signifie laisser résonner. « Que ces paroles restent sur ton cœur, que tu les murmures jour et nuit » (Josué 1,8). Il ne s’agit pas de répéter, mais de laisser descendre en soi une parole, un silence, une présence, comme un murmure au-delà des pensées. Méditer, c’est se déposer. C’est se laisser traverser par le souffle, revenir à la source en soi. Ce n’est pas un repli, mais une ouverture, un mouvement intérieur d’écoute, où l’on cesse de faire pour simplement être. Dans une perspective non-duelle, la méditation devient un retour à l’évidence : ce que nous cherchions à l’extérieur est déjà là. Plus qu’un exercice, elle est un regard posé autrement, une écoute habitée, une manière de se tenir dans l’unité, dans la paix de ce qui est. -> voir aussi prière
- Messie Le Messie n’est pas un personnage attendu pour rétablir un ordre extérieur, ni un chef politique ou religieux. Il est l’accomplissement de l’humain pleinement éveillé, le signe que l’unité est possible dès maintenant. Attendre le Messie, c’est ne pas voir qu’il est déjà là, dès que nous nous ouvrons à l’instant présent. Synonyme: Christ
- me voici "Me voici" (Hineni en hébreu) n’est pas une simple présence physique, ni une formule anodine. C’est un engagement, une disponibilité totale, une ouverture à l’instant où tout peut basculer. Dans la Bible, cette parole marque les grandes traversées. Abraham répond "Me voici" lorsqu’il est appelé (Genèse 22,1). Moïse dit "Me voici" devant le buisson ardent (Exode 3,4). Marie, à l’annonce de l’ange, s’offre dans un "Qu’il me soit fait selon ta parole." (Luc 1,38). "Me voici" est un seuil : il ne s’agit pas seulement d’être là, mais d’être prêt-e à se laisser traverser, à accueillir ce qui vient sans savoir où cela mène. C’est un oui qui ne maîtrise pas, une présence qui s’offre sans conditions. Nous sommes souvent dispersé-e-s, hésitant-e-s, partiellement là. Dire "Me voici", c’est réunifier notre être, cesser de fuir, nous tenir debout devant ce qui nous appelle, sans masque et sans peur. Ce n’est pas un mot magique, mais une attitude intérieure. Là où nous osons être pleinement là, disponibles à l’instant, quelque chose de plus grand peut advenir.
- miracle Dans les Évangiles, le mot « miracle » n’existe pas en tant que tel : on y parle de signe (semeion), de puissance (dynamis) ou d’œuvre (ergon). Ces termes grecs ne désignent pas une entorse aux lois du monde, mais une manifestation de la Vie dans toute sa profondeur. Le signe ne vient pas d’ailleurs, il révèle ce qui est déjà là. Il n’impose pas la foi, il ouvre les yeux de celles et ceux qui regardent autrement. Le miracle n’est pas un événement extraordinaire qui surgirait du dehors alors que nous n’y sommes pour rien. Ce que nous appelons miracle n’est donc pas une intervention soudaine et arbitraire de l’Au-delà, mais un dévoilement de la réalité quand elle est vue depuis la Source. Dans une lecture non-duelle, le miracle est un événement de conscience : il advient quand quelque chose en nous consent à s’ouvrir, à s’accorder à la Vie qui agit déjà. Les vents apaisés parlent de nos tempêtes intérieures, lorsque les parts de nous-mêmes cessent de s’affronter ; les pains partagés sont la nourriture donnée à chacune pour qu’elle trouve sa juste place. Rien n’est imposé de l’extérieur : c’est une rencontre entre la Puissance qui traverse tout et la disponibilité de l’humain. C’est pourquoi Jésus dit souvent : « Ta foi t’a sauvé. » Ce n’est pas une récompense, mais la reconnaissance d’un mouvement intérieur qui rend possible le passage. Le miracle n’arrive pas sans nous : il se révèle à travers nous, quand la peur se relâche, que le cœur s’ouvre et que l’Unité respire à nouveau dans le visible.
- miséricorde La miséricorde n’est pas une simple indulgence ni une pitié condescendante. Ce n’est pas ignorer les fautes ni minimiser les blessures. Dans la Bible, elle est un mouvement profond de l’Être, un amour qui voit la fragilité sans la rejeter, qui accueille sans condition. En hébreu, le mot rahamim (miséricorde) vient de rehem, qui signifie "entrailles" ou "matrice". La miséricorde est donc un amour viscéral, un amour maternel qui porte et relève, qui ne se lasse pas de donner une seconde naissance. Elle n’est pas un simple pardon accordé d’en haut, elle est l’expérience de se savoir aimé-e au-delà de toute mesure, même là où l’on se croyait indigne ou perdu-e. Être touché-e par la miséricorde, c’est être restauré-e dans sa dignité, retrouver l’espace où la Vie peut à nouveau circuler librement.
- Moïse Moïse n’est pas seulement un personnage historique, il est une figure de la traversée, du passage. Comme lui, nous pouvons avoir l’impression de ne pas être à la hauteur ("Je ne suis pas éloquent." – Exode 4,10), et pourtant, c’est à travers nos fragilités que l’Essentiel agit. Moïse est celui qui entend l’appel de l’Infini dans le feu qui brûle sans consumer. Il est celui qui guide vers la liberté, mais qui ne peut pas faire le chemin à la place des autres. Il est un passeur, mais chacun-e doit traverser la mer en soi-même.
- Monde Le monde n’est pas un lieu opposé au Royaume, ni une réalité à fuir. Il est l’espace où l’Infini se donne à voir, où l’Être invisible prend chair. Si le Royaume est l’espace du "Père" en nous, la dimension de l’Unité qui nous habite, alors le monde est l’espace du "Fils", là où cette Unité se manifeste dans la diversité, dans la matière, dans le temps et le mouvement. Le monde est le lieu de l’Incarnation, où l’Esprit prend forme, où l’Infini s’exprime dans le fini. Mais il peut aussi être le lieu de l’oubli, là où l’égo s’identifie aux apparences et se coupe du Souffle. Ce monde n’est pas seulement extérieur. Il est aussi en nous : le monde des pensées, des émotions, des attachements. Ce monde intérieur peut être un espace de création et de conscience, mais aussi un labyrinthe où nous nous perdons, prisonnier-e-s de nos propres constructions mentales. Jésus dit : "Vous êtes dans le monde, mais vous n’êtes pas du monde." (Jean 17,16). Il ne s’agit pas de rejeter le monde, mais de l’habiter sans s’y enfermer, de le traverser sans se laisser enfermer par l’illusion du séparé. Lorsque nous voyons le monde non comme un obstacle, mais comme un espace d’incarnation du Royaume, il devient le lieu même où l’Essentiel peut se révéler, ici et maintenant.
- mort La mort n’est pas l’opposé de la vie, mais la fin d’une forme, l'épreuve de l'inconnu, une dépossession radicale. Elle marque l’arrêt, l’irréversible, le "plus jamais", ce qui ne reviendra plus sous cette apparence. Elle nous confronte à l’inconnu, au vide, à ce que nous ne pouvons ni saisir ni retenir. Dans la Bible, la mort est vécue comme un arrachement, une perte. Jésus lui-même l’affronte dans l’angoisse de Gethsémani : "Mon âme est triste à en mourir." (Matthieu 26,38). Il ne la minimise pas. Elle est silence, rupture, finitude. Mais il existe une autre forme de mort. Jésus voit comme morts ceux et celles qui vivent enfermés dans leur égo, divisés en eux-mêmes, séparés de l’Unité. "Laisse les morts enterrer leurs morts." (Luc 9,60). Ils passent à côté de leur propre vie, enfermés dans une illusion qui les coupe du Vivant. Il faut mourir à cette vie égotique pour renaître autrement. "Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit." (Jean 12,24). Perdre sa vie, c’est perdre ce qui enferme, pour s’ouvrir à une autre manière d’être. Nous ne savons rien - ou si peu - de ce qu’il y a après la mort. Ce que nous pouvons reconnaître, c’est qu’elle ramène à l’Essentiel, à ce qui demeure lorsque tout s’efface. Elle n’est pas un simple passage, mais une épreuve qui nous dépouille de tout ce que nous croyions être.
- mouton Le mouton évoque souvent la douceur, la docilité, mais aussi la tendance à suivre le troupeau sans questionner. Dans la Bible, il est l’image du peuple, fragile et vulnérable, souvent égaré, ayant besoin d’un berger pour retrouver le chemin. Être mouton, ce n’est pas un défaut en soi, mais c’est une part de nous qui cherche la sécurité dans l’appartenance, qui préfère l’obéissance à la liberté, la conformité à la responsabilité. Mais cette part peut aussi être transfigurée : le mouton devient alors celui qui écoute, qui se laisse guider non par peur, mais par confiance intérieure. Il ne s’agit plus de suivre n’importe quelle voix, mais de reconnaître en soi la voix du vrai berger, celle qui appelle par notre nom. En nous, le mouton est cette part simple, aimante, mais vulnérable, qui peut se perdre si elle ne revient pas au cœur. Lorsqu’elle s’unit au discernement du Je-suis, elle cesse d’être aveugle pour devenir ouverte, confiante, et profondément libre.
- murmure Le murmure est une parole qui ne force pas, un souffle discret qui ne s’impose qu’à celui ou celle qui sait écouter. Dans la Bible, Élie cherche Dieu dans la puissance du vent, du tremblement de terre et du feu, mais ne le trouve pas. Ce n’est que dans "le murmure d’un souffle léger" qu’il perçoit enfin la Présence (1 Rois 19,12). Le murmure ne capte pas l’attention par la force, il invite à une écoute plus fine, plus intérieure. Il ne parle pas au mental agité, mais au cœur disponible. Il est cette voix que l’on n’entend que lorsque tout en nous s’apaise. Nous vivons souvent dans le fracas des pensées et des certitudes. Mais l’Infini ne crie pas, il chuchote. Là où nous cessons d’attendre des signes éclatants, où nous nous ouvrons simplement à ce qui est, le murmure devient audible. Il n’apporte pas de réponses toutes faites, mais il révèle une présence, un espace où l’Essentiel se dit sans bruit.