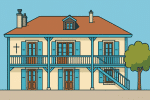Peut-on vraiment dé-finir l’Infini, si définir signifie lui mettre une limite ?

Ce lexique est vivant, en perpétuelle évolution. Il se transforme au fil de vos questions et de la recherche commune à la Maison bleu ciel.
Les définitions proposées ici ne sont pas des vérités figées, mais des pistes, des invitations à explorer, à questionner, à reformuler. Provisoires, elles ouvrent un chemin, offrent des repères sans enfermer, éclairent sans figer le mystère. Si elles ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté. Et si elles vous inspirent d’autres mots, d’autres formulations, suivez cet élan : c’est dans cette dynamique que ce lexique prend tout son sens.
Dans le domaine spirituel, les mots balbutient souvent. Ils ne sont que des éclats, des tentatives imparfaites pour pointer vers l’Indicible. Et au fil du temps, ils ont accumulé des couches, des interprétations, des rigidités qui les éloignent de leur source vive.
Les mots doivent être lavés pour retrouver leur limpidité. Ils ne prennent leur véritable sens que lorsqu’ils sont réaccordés à l’expérience, à la présence, à la résonance intime avec l’Essentiel. Ici, nous ne cherchons pas tant à les définir qu’à les laisser respirer à nouveau, à les délester de ce qui les alourdit pour qu’ils puissent redevenir ce qu’ils sont : des portes ouvertes vers l’Infini.
Tout le lexique

j
- Jacob Jacob est celui qui chemine, celui qui ne reste pas figé dans une identité mais qui, à travers l’épreuve, découvre une autre dimension de lui-même. Son nom signifie "celui qui talonne", car dès le ventre maternel, il agrippe le pied de son frère Ésaü (Genèse 25,26). Il est d’abord le rusé, celui qui prend, qui saisit, qui cherche à obtenir par la ruse ce qu’il pense ne pas avoir. Mais Jacob n’en reste pas là. Une nuit, au bord du gué du Yabboq, il lutte avec un être mystérieux jusqu’à l’aube (Genèse 32,25-31). Il ne cherche plus à fuir ni à tromper, mais il affronte, il tient bon, il ose le face-à-face. Blessé, transformé, il reçoit alors un nouveau nom : Israël, "celui qui a lutté avec l’Infini et avec les humains, et qui a tenu". En nous, Jacob est cette part qui résiste, qui cherche, qui lutte avec la vie, avec soi-même, avec l’Invisible. Il est le passage du calcul à l’abandon, du contrôle à la confiance, du Jacob qui veut saisir au Jacob qui accepte d’être saisi. Sa lutte ne le détruit pas, elle le révèle. Blessé, il marche désormais en boitant, mais il a vu l’Essentiel, il a traversé la nuit et porte en lui une lumière nouvelle.
- Jacques Jacques, le frère de Jean, est le disciple du feu. Avec son frère, il est surnommé "fils du tonnerre". Il est celui qui brûle d'agir, qui veut voir la justice triompher, qui demande à siéger à côté de Jésus dans la gloire. Mais Jésus l’invite à un autre chemin : non pas celui du pouvoir, mais celui du service. Jacques apprend à transformer son ardeur en force intérieure, à laisser le feu en lui devenir lumière plutôt que violence. Il est cette part en nous qui veut que les choses avancent, qui s’impatiente de voir la vérité s’imposer. Mais qui, peu à peu, découvre que la force véritable est une force intérieure, un feu qui éclaire sans consumer.
- Jean Jean est celui du regard profond, celui qui "se penche sur la poitrine de Jésus" (Jean 13,23), celui qui écoute le cœur de l’Essentiel. Jean est le disciple du regard profond, de l’intimité avec la Présence. Il ne fuit pas la croix, il demeure, simplement. Jean, c’est la part en nous qui ne cherche pas à prouver, mais à goûter. Qui n’agit pas dans l’urgence, mais qui sait que la vérité se révèle dans la profondeur. Il est cet espace en nous qui peut s’abandonner pleinement à l’amour, sans besoin de certitudes.
- Jean-Baptiste Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert : "Préparez le chemin." (Matthieu 3,3). Il est celui qui ouvre un passage, qui prépare à l’éveil en annonçant une Présence plus vaste que lui. Il incarne cette part en nous qui sait que l’essentiel n’est pas de se mettre en avant, mais de s’effacer devant ce qui vient. Il est l’humilité de celui qui reconnaît que sa mission n’est pas de capter la lumière, mais d’aider à y entrer. "Il faut qu’Il croisse et que moi je diminue." (Jean 3,30). Ces mots de Jean-Baptiste résonnent comme un appel intérieur : l’égo, ce moi qui veut exister par lui-même, est appelé à diminuer pour laisser émerger ce qui est plus vaste. Non pas disparaître dans l’effacement de soi, mais s’ouvrir, se décentrer, cesser de vouloir tout contrôler pour laisser la Vie circuler librement. Jean-Baptiste nous invite à traverser cette étape intérieure où l’égo apprend à s’incliner, non par contrainte, mais par reconnaissance : reconnaître qu’il n’est pas la source, mais un passage, un humble serviteur du Vivant.
- Jérusalem Jérusalem n’est pas seulement une ville de pierre, un lieu géographique marqué par l’histoire et les divisions. Elle est un espace intérieur, une quête d’unité au cœur de la dispersion. Le nom Jérusalem vient de l’hébreu Yerushalayim (ירושלים), qui pourrait signifier "Fondation de la paix" (Yeru = fondation, Shalayim lié à shalom, la paix). Mais cette paix dont elle porte le nom semble toujours à venir, jamais totalement réalisée. Dans la Bible, Jérusalem est la ville du Temple, le centre spirituel où le divin et l’humain se rencontrent. Mais elle est aussi le lieu des conflits, des trahisons, des renversements. Jésus y entre acclamé, puis y est condamné. Elle est à la fois le sommet et l’épreuve, la promesse et la croix. En nous, Jérusalem est ce lieu où tout converge, là où nos parts dispersées sont appelées à se rassembler. Elle est la cité intérieure où le sacré et le quotidien se rejoignent, où l’égo est invité à s’incliner devant l’Unité. Dans l’Apocalypse, elle devient la Jérusalem céleste, non plus un lieu à défendre, mais une présence qui descend, une cité sans temple car "Dieu est tout en tous" (Apocalypse 21,22). Nous marchons vers Jérusalem lorsque nous avançons vers cette unification intérieure, vers un espace où il n’y a plus ni dedans ni dehors, mais un seul et même Souffle.
- Je-suis Le Je-suis n’est pas un simple "moi", ni une affirmation d’identité individuelle. Il est la Présence pure, la conscience qui est avant toute forme, avant tout rôle, avant toute séparation. Nous sommes constitués de trois dimensions : le corps, qui nous relie à la matière et au vivant, la psyché, qui porte nos pensées, nos émotions, nos mémoires, et le Je-suis, la conscience profonde, ce qui demeure au-delà de tout mouvement. Dans la Bible, lorsque Moïse demande à l’Infini son nom, la réponse est : "Je suis celui qui suis/qui deviens" (Ehyeh Asher Ehyeh, Exode 3,14). Ce n’est pas un nom figé, mais un mouvement, un être en devenir, un Souffle qui ne se laisse enfermer dans aucune définition. Jésus reprend cette parole en osant dire "Moi, Je-suis" (en grec ancien: ego eimi), affirmant ainsi l’unité avec l’Être qui est, ici et maintenant. Ce Je-suis n’est pas un "moi" séparé des autres, mais le Je universel, l’Être vivant en chacun-e, ce qui demeure au-delà des identifications. Certain-e-s l’appellent le maître intérieur, non comme une entité distincte, mais comme Ce qui sait en nous, qui voit au-delà des illusions, qui est déjà relié à l’Essentiel. En nous, le Je-suis est ce qui précède nos noms, nos histoires, nos attachements. C’est le point d’unité au cœur de l’être, la Présence que rien ne peut limiter. Quand nous cessons de nous prendre pour une identité construite, nous découvrons que nous sommes déjà là, pleinement, sans rien ajouter ni retirer.
- Jésus Jésus est d’abord un être singulier, ancré dans l’histoire, né dans un temps et un lieu donnés. Il marche, parle, enseigne, aime, souffre, meurt. Il vit pleinement sa condition humaine et en révèle la profondeur. Mais il n’est pas seulement un personnage historique, un prophète ou un maître spirituel. Il est "celui qui traverse" : la faim, la peur, les attachements, les illusions, la souffrance, la mort elle-même. Il témoigne que rien ne peut enfermer la Vie. Jésus est celui qui ne retient rien, qui ne s’agrippe ni au pouvoir, ni à une identité figée. Il est pure disponibilité, présence offerte. Son chemin est un chemin de kénose, un dépouillement qui ouvre à l’Essentiel. Ainsi, il incarne pleinement le "Fils de l’humain", celui qui ne s’identifie plus aux jeux de l’ego. Lorsqu’il dit "Je suis", il ne parle pas de lui en tant qu’individu séparé, mais du "Je-suis" vivant en chacun-e, cette conscience profonde où toute division s’efface, qui embrasse le fini et l’Infini, qui relie le multiple à l’Un. Dans cette transparence à l’Infini, Jésus devient le Christ, non comme un titre extérieur, mais comme l’expression vivante de l’Unité. Il incarne l’union du fini et de l’Infini, du visible et de l’Invisible, de l’humain et du divin. Mais le Christ n’est pas un personnage extérieur à suivre de loin. Il est une réalité à éveiller en soi. "Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi." (Galates 2,20). Jésus ne nous montre pas un chemin extérieur, mais une voie intérieure, un espace où l’Unité se révèle, où la Présence peut s’ouvrir en nous, ici et maintenant.
- jeûne Le jeûne n’est pas une privation pour mériter une récompense spirituelle, ni une ascèse qui valorise la souffrance. C’est un espace de liberté, un dépouillement qui permet d’écouter autrement, de creuser en nous la faim d'Essentiel. Il ne s’agit pas seulement de se priver de nourriture, mais de tout ce qui nous encombre et nous détourne de la Présence.
- Job Job est l’homme juste qui perd tout, celui qui traverse l’incompréhensible, qui voit s’effondrer toutes ses certitudes et doit faire face à une souffrance sans cause apparente. Son histoire interroge : pourquoi l’épreuve ? Pourquoi le malheur frappe-t-il même les justes ? Mais Job n’est pas seulement un personnage biblique. Il est une part de nous, celle qui cherche un sens à la souffrance, qui refuse les explications simplistes, qui crie vers l’Infini et ne se contente pas de réponses toutes faites. Ses amis lui offrent des explications morales, des tentatives pour justifier l’injustifiable. Mais Job ne cède pas. Il reste debout dans son questionnement, dans son non-savoir, jusqu’à ce qu’un autre regard s’ouvre. À la fin du livre, il ne reçoit pas de réponse logique, mais une expérience plus vaste : il passe du "je sais" au "je vois". "Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t’a vu." (Job 42,5). En nous, Job est celui qui est dépouillé de tout, mais qui, dans cet effondrement, découvre l’Ouvert. Il est le passage du pourquoi au comment vivre, de l’explication au face-à-face avec l’Infini. L’épreuve ne lui donne pas de réponses, mais elle lui révèle une Présence plus grande que ses questions.
- joie La joie n’est pas le simple plaisir, ni une émotion passagère qui dépend des circonstances. Elle est un état d’être, une plénitude qui surgit lorsque nous cessons de nous agripper, lorsque nous nous laissons traverser par la Vie telle qu’elle est. Dans la Bible, la joie est souvent liée à la présence de l’Infini : "Que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite." (Jean 15,11). Elle n’est pas une récompense, mais une conséquence naturelle d’un cœur ouvert, d’un être réconcilié avec lui-même et avec l’instant. La joie ne se force pas, elle se reçoit. Elle est là lorsque nous arrêtons de chercher ailleurs, lorsque nous nous tenons simplement dans l’Ouvert, sans attente, sans besoin de saisir. Elle est le rire qui jaillit sans raison, la gratitude qui s’éveille sans calcul, la paix qui affleure même au milieu du chaos. Elle peut coexister avec la tristesse, car elle n’est pas l’opposé de la douleur, mais un espace plus vaste où tout peut être accueilli. La joie véritable n’est pas celle qui chasse l’ombre, mais celle qui sait l’embrasser sans s’y perdre. Elle est la signature du Vivant en nous, la reconnaissance silencieuse que, malgré tout, tout est déjà là.
- Joseph, époux de Marie Joseph, époux de Marie, n’est pas un homme de grandes paroles. Il est présence discrète, fidélité silencieuse, force intérieure qui veille et protège sans retenir. Dans les Évangiles, il est un "homme droit" qui écoute et qui agit sans bruit. Lorsqu’il apprend que Marie est enceinte, il ne réagit ni par rejet ni par colère. Il cherche une issue juste, sans exposer ni blesser. Mais un songe lui révèle un chemin plus vaste : ne pas fuir, mais accueillir (Matthieu 1,20-21). Joseph est l’homme des songes, celui qui sait entendre l’Invisible et suivre des routes inattendues. Il traverse les nuits, fuit en Égypte, revient en silence, toujours au service de ce qui doit naître. Il n’impose rien, il accompagne, il ouvre un espace pour que la Vie advienne. Il n’est pas le père biologique de Jésus, mais il l’accueille comme son fils. Il incarne la paternité non comme possession, mais comme transmission, une présence qui donne sans s’approprier. En nous, Joseph est la part qui acquiesce à ce qui est, qui veille sans bruit, qui protège sans enfermer, qui laisse grandir sans retenir. Il est l’accueil qui ne force pas, la force qui ne s’impose pas, la présence qui permet à l’Essentiel de se dire.
- Joseph, fils de Jacob et Rachel Joseph, fils de Jacob et Rachel, est une figure de la résilience, celui qui tombe sans se briser, traverse sans se perdre, et transforme l’épreuve en passage. Son nom signifie "qu’il ajoute", et sa vie est une succession de pertes et de renaissances, où chaque chute devient un chemin vers plus vaste. D’abord privilégié et protégé, il est le fils préféré de Jacob, né de son amour pour Rachel. Mais très vite, il est trahi par ses frères, vendu, exilé, emprisonné (Genèse 37). Il connaît l’abandon, l’injustice, la solitude, autant de moments où tout pourrait s’arrêter. Pourtant, il ne s’effondre pas : il s’adapte, il apprend, il se relève. Joseph est aussi celui qui interprète les rêves, non seulement les siens, mais ceux des autres. Il sait lire au-delà des apparences, percevoir ce qui se trame derrière le chaos. Grâce à cette vision, il devient gouverneur d’Égypte et sauve son peuple, y compris ceux qui l’avaient rejeté. Mais son plus grand passage est le pardon. Lorsqu’il retrouve ses frères, il pourrait se venger. Pourtant, il choisit une autre lecture de son histoire : "Vous aviez voulu me faire du mal, mais l’Infini l’a transformé en bien." (Genèse 50,20). En nous, Joseph est cette part qui apprend à voir autrement, qui refuse d’être figée par le passé, qui fait de chaque blessure une ouverture plutôt qu’un enfermement. Il est la résilience vivante : celle qui ne nie pas l’épreuve, mais la traverse jusqu’à en faire un lieu de vie.
- Judas Judas n’est pas seulement le traître de l’histoire, il est une part de nous. Il incarne ce qui en nous doute que l’amour soit suffisant, ce qui cherche à contrôler, à forcer le cours des choses. Il trahit peut-être moins par haine que par désillusion : il attendait un Messie fort et découvre un maître qui se laisse prendre. En lui, il y a la peur d’avoir suivi une voie sans issue, l’angoisse de s’être trompé. Il est cette part en nous qui veut forcer le cours des choses, qui ne comprend pas un amour qui ne s’impose pas. Mais son véritable drame n’est pas sa trahison, c’est de penser qu’il ne peut plus revenir. Il est ce moment où l’on croit que tout est perdu, où l’on oublie que l’Ouvert est toujours là, même dans la nuit la plus profonde.
- jugement Le jugement n’est pas une condamnation venue d’un tribunal céleste. Il est ce qui met en lumière, ce qui révèle la vérité d’un être ou d’une situation. Être jugé, c’est être vu tel que l’on est, sans masque. Le véritable jugement n’écrase pas, il éclaire et libère. Le jugement dernier est le dernier jugement que l'on porte sur soi.
- Juifs Le mot Juif (Yehoudi en hébreu) ne désigne pas seulement un peuple ou une tradition religieuse, mais une manière d’être en relation avec l’Infini. Il évoque une mémoire vivante, une fidélité en marche, une quête jamais achevée. Dans la Bible, être Juif, c’est être en Alliance, c’est traverser les exils, les désertions, les renaissances, sans jamais perdre le fil d’une promesse intérieure. C’est chercher, interpréter, questionner sans relâche, car la vérité ne se possède pas, elle se reçoit dans le dialogue avec la Vie. Dans l’Évangile, Jésus, lui-même Juif, dit : "Le salut vient des Juifs." (Jean 4,22). Cette parole ne parle pas d’un peuple élu au détriment des autres, mais d’une vocation universelle : celle d’être des chercheur-se-s de l’Essentiel, des êtres en marche vers l’Unité. Nous sommes tous Juifs dans cette dimension intérieure : chaque fois que nous nous mettons en route, que nous cherchons au-delà des évidences, que nous faisons de notre vie un espace d’écoute et d’Alliance, nous entrons dans cette lignée spirituelle qui traverse l’histoire et qui, plus qu’une appartenance, est un appel.
- justice La justice de l’Essentiel n’est pas un système de récompense et de punition. Elle ne pèse pas les mérites sur une balance extérieure. Dans la Bible, la justice est ce qui remet chaque chose à sa juste place, ce qui restaure l’équilibre. Être juste, ce n’est pas seulement respecter des règles, c’est être ajusté à la Vie, à la relation, à ce qui est vrai et bon. C’est permettre à l’Autre d’exister pleinement, sans le réduire à nos attentes ou à nos jugements.