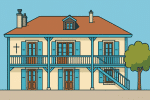Peut-on vraiment dé-finir l’Infini, si définir signifie lui mettre une limite ?

Ce lexique est vivant, en perpétuelle évolution. Il se transforme au fil de vos questions et de la recherche commune à la Maison bleu ciel.
Les définitions proposées ici ne sont pas des vérités figées, mais des pistes, des invitations à explorer, à questionner, à reformuler. Provisoires, elles ouvrent un chemin, offrent des repères sans enfermer, éclairent sans figer le mystère. Si elles ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté. Et si elles vous inspirent d’autres mots, d’autres formulations, suivez cet élan : c’est dans cette dynamique que ce lexique prend tout son sens.
Dans le domaine spirituel, les mots balbutient souvent. Ils ne sont que des éclats, des tentatives imparfaites pour pointer vers l’Indicible. Et au fil du temps, ils ont accumulé des couches, des interprétations, des rigidités qui les éloignent de leur source vive.
Les mots doivent être lavés pour retrouver leur limpidité. Ils ne prennent leur véritable sens que lorsqu’ils sont réaccordés à l’expérience, à la présence, à la résonance intime avec l’Essentiel. Ici, nous ne cherchons pas tant à les définir qu’à les laisser respirer à nouveau, à les délester de ce qui les alourdit pour qu’ils puissent redevenir ce qu’ils sont : des portes ouvertes vers l’Infini.
Tout le lexique

p
- pain de ce jour Le pain de ce jour dont parle la prière du Notre Père n’est pas seulement la nourriture matérielle qui nous soutient physiquement. Il est tout ce qui nous est donné pour avancer, ici et maintenant. Demander notre pain de ce jour, c’est s’ouvrir à recevoir ce dont nous avons besoin à l’instant présent, sans nous projeter dans le manque du futur ni nous agripper au passé. C’est une prière du lâcher-prise, une confiance que, pour aujourd’hui, il y aura ce qu’il faut.
- Pâques Pâques n’est pas seulement le souvenir d’un tombeau vide ou d’un miracle du passé. C’est un passage, une traversée : de l’enfermement à l’Ouvert, de la peur à la confiance, de l’illusion de séparation à la reconnaissance de l’Unité. La résurrection n’est pas un retour à la vie d’avant, mais un éveil à une vie plus vaste, une manière de voir et d’être qui ne dépend plus des limites habituelles. Chaque instant peut être Pâques si nous consentons à mourir à ce qui nous enferme pour renaître à ce qui est vrai.
- parabole Une parabole n’est pas une simple histoire avec une morale. C’est un chemin ouvert, un espace où l’Infini parle à travers l’image et le symbole. Elle ne livre pas un message figé, mais invite à un déplacement intérieur. Une parabole ne se comprend pas intellectuellement, elle s’accueille et résonne au rythme de notre propre ouverture.
- paradis Le paradis n’est pas un lieu lointain après la mort, ni une récompense réservée à quelques élu-e-s. Il est un état d’être, une expérience d’unité où la séparation s’efface, où tout est perçu dans sa transparence et sa plénitude. Dans la Bible, le paradis est souvent associé au jardin d’Éden, cet espace d’harmonie où l’humain vivait en communion avec l’Infini avant d'en être chassé. Mais il n’est pas seulement un passé perdu : Jésus le révèle comme une réalité toujours accessible, ici et maintenant. Au brigand crucifié à ses côtés, il dit : "Aujourd’hui, tu seras avec moi en paradis." (Luc 23,43). Le paradis n’est pas un ailleurs, il est un regard qui s’ouvre. Il est là chaque fois que l’on cesse de se croire séparé-e, chaque fois que l’on entre dans la confiance pure, dans l’instant pleinement vécu. Ce n’est pas un lieu à atteindre après la mort, mais un état de conscience qui nous attend dès que nous nous laissons traverser par l’Ouvert. Il est la présence retrouvée, la joie sans objet, l’Unité qui, derrière toutes nos errances, n’a jamais cessé d’être là.
- pardon Le pardon n’est pas un oubli forcé, ni un effort moral pour effacer une faute. Il n’est pas un acte que l’on pose pour satisfaire une règle, mais un mouvement de l’être vers la liberté. Pardonner, ce n’est pas dire que l’offense n’a pas existé, ce n’est pas excuser ni minimiser. C’est refuser de rester enfermé-e dans le poids du passé. Le pardon ne libère pas seulement l’autre, il nous libère nous-même de l’enfermement dans la rancune ou la douleur. Dans la tradition biblique, le pardon est un passage, une traversée : il ouvre un espace où quelque chose de neuf peut advenir. Il ne dépend pas de la réaction de l’autre, il est un choix intérieur de ne plus laisser le mal définir notre relation.
- Parole de Dieu La Parole de Dieu n’est pas un texte figé, ni un discours extérieur dictant des vérités à croire. Elle est vivante, toujours en mouvement, toujours en train de se dire dans l’instant. Elle ne se limite pas aux mots des écritures : elle parle dans le silence, dans le langage des arbres, du vent et des rivières. Elle se révèle aussi dans la relation, dans les rencontres qui nous ouvrent, dans les regards qui éveillent. Cette Parole ne se possède pas, elle se reçoit. Elle ne s’impose pas, elle murmure à qui sait écouter. Elle n’est pas à comprendre seulement avec l’intellect, mais à goûter, à laisser résonner dans le cœur et le corps. Elle est souffle, présence, invitation à entrer dans un dialogue vivant avec tout ce qui est. Voir aussi Ecritures et Bible
- passions Le mot passion vient du latin passio, lui-même dérivé du verbe pati, qui signifie "subir, souffrir, endurer". À l’origine, la passion désigne ce qui nous affecte, ce que nous subissons, plutôt qu’un élan actif. Dans la tradition chrétienne, la Passion du Christ illustre ce sens : ce n’est pas une exaltation émotionnelle, mais une traversée de la souffrance, un passage qui mène à une transformation profonde. Mais avec le temps, le mot a pris un autre sens : celui d’un élan puissant, d’un désir qui nous anime, qui peut nous emporter ou nous orienter. Dans la philosophie antique, notamment chez les Stoïciens, les passions sont perçues comme des forces qui troublent l’âme, l’éloignant de la paix intérieure. Dans la tradition biblique et spirituelle, les passions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont des forces puissantes, des élans de vie qui nous traversent, nous poussent à désirer, à créer, à nous engager. Mais elles peuvent aussi nous enfermer, nous attacher, nous dominer. Elles sont donc vues comme des énergies à purifier. Lorsqu’elles nous possèdent, les passions nous écartent de nous-mêmes. Elles deviennent avidité, colère, jalousie, attachement excessif. Elles nous dispersent, nous enferment dans la réaction et l’illusion d’un manque à combler. Mais lorsque nous les reconnaissons sans nous y identifier, elles deviennent un chemin d’unification. Elles ne sont plus des forces chaotiques, mais des énergies orientées, offertes à plus grand que nous. Les passions ne sont donc pas à combattre, mais à traverser avec conscience. Ce qui nous emprisonne peut devenir ce qui nous libère, si nous apprenons à les vivre sans nous y perdre.
- pauvre Être pauvre, dans une lecture non-duelle, ne signifie pas manquer, mais ne pas s’agripper, ne pas s’enfermer dans l’avoir, le savoir ou le pouvoir. La pauvreté n’est pas une absence, mais une disponibilité de celui ou celle qui ne retient rien, un espace laissé libre pour accueillir l’Essentiel. Jésus dit : "Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux." (Matthieu 5,3). Il ne parle pas d’une misère matérielle, mais d’un état intérieur où l’on ne s’accroche à rien, où l’on ne se définit plus par ses possessions, ses certitudes ou ses réussites. Le pauvre en esprit est celui ou celle qui se tient dans l’Ouvert, qui ne se croit pas arrivé-e, qui reste disponible à ce qui se donne. Il-elle n’est pas vide, il-elle est transparent-e, prêt-e à être traversé-e par la Vie. La vraie pauvreté n’est pas un manque, mais une plénitude qui ne s’attache à rien. Là où nous cessons de retenir, nous découvrons que tout est déjà là.
- péché Traditionnellement vu comme une faute, il peut être compris comme une séparation illusoire d’avec l’Essentiel. Le mot grec hamartia signifie "manquer la cible" : c’est ne pas reconnaître notre véritable nature. Le péché n’est donc pas une infraction à une loi divine, mais un éloignement de la Vie. C’est une manière d’être qui nous coupe de l’Essentiel. Ce n’est pas une faute à punir, mais un oubli de soi à reconnaître pour retrouver le chemin intérieur.
- pélerinage Le vrai pèlerinage n’est pas un déplacement géographique vers un lieu sacré. C’est une marche intérieure, une transformation de notre manière d’habiter le monde. Ce n’est pas l’arrivée qui compte, mais le chemin, l’expérience d’être en mouvement vers plus d’ouverture et de profondeur, vers l'Etre-qui-est.
- Pentecôte La Pentecôte n’est pas seulement un événement du passé où des disciples auraient reçu un don spirituel exceptionnel. Elle est une réalité toujours actuelle : celle d’un souffle qui traverse et renouvelle, d’une ouverture où l’Infini se donne à vivre pleinement. Le Souffle (l’Esprit) ne descend pas d’en haut comme un pouvoir extérieur. Il jaillit du dedans, comme un feu qui éclaire, une parole qui libère, une inspiration qui met en mouvement. Il ne s’impose pas, il se reçoit dans la disponibilité. Vivre la Pentecôte, c’est laisser ce Souffle nous traverser, nous éveiller à une parole qui n’appartient à personne et qui, pourtant, nous fait nous reconnaître dans une même unité.
- Père Le père n’est pas une autorité au-dessus, ni un homme projeté dans le ciel. Il n’est pas celui qu’on craint, qu’on supplie ou qu’on fuit. Ce mot, pourtant si chargé de nos blessures humaines, ne parle pas d’un modèle terrestre idéalisé. Dans la bouche de Jésus, il désigne un état de conscience : celui de la Source qui engendre sans posséder, qui donne l’être sans le retenir. Dieu n’est pas notre père comme un être serait à l’origine d’un corps, mais comme Celui qui donne notre être lui-même. Dire « Père », ce n’est pas s’adresser à quelqu’un, c’est reconnaître que notre être profond, notre essence spirituelle, est déjà en lien vivant avec cette Source. Elle nous engendre ici et maintenant, non pas par la chair, mais dans l’Esprit. Nous ne sommes pas orphelins ; nous sommes enfants de l’Être. Cet état de conscience du Père est celui d’un amour sans attente, d’un don sans calcul. Il est la maturité de l’être : quand je cesse de chercher à combler un manque, je deviens moi-même don, transparence, canal du Vivant. Le Père n’est pas un personnage, mais une Présence. Une qualité d’être à laquelle je peux m’ouvrir et que je peux incarner. Dire Père, c’est se souvenir de cette origine vivante en soi, et s’y relier. C’est habiter le Royaume qui est déjà là. Pas ailleurs, pas plus tard. Maintenant.
- perfection La perfection n’est pas une absence de défauts, ni une conformité à un idéal figé. Dans la tradition biblique, être parfait, c’est être accompli, pleinement ajusté à ce que l’on est appelé à être. "Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait." (Matthieu 5,48). Cette invitation ne parle pas d’un état de pureté inaccessible, mais d’une plénitude : être entier, sans division intérieure, aligné avec l’Essentiel. La perfection n’est pas dans le contrôle ni dans la maîtrise de soi, mais dans l’abandon à la Vie qui circule librement. Elle est moins une exigence qu’un dépouillement : se laisser être, sans chercher à se corriger en fonction d’un modèle extérieur. Nous touchons la perfection non lorsque nous devenons irréprochables, mais lorsque nous cessons de nous diviser, lorsque nous nous offrons totalement, tels que nous sommes, à l’Infini qui nous traverse.
- peuple Un peuple n’est pas seulement une collectivité liée par une histoire, une langue ou une culture. Il est un mouvement, une appartenance vivante, une mémoire qui se tisse et se transforme. Dans la Bible, le peuple est en marche : il traverse le désert, il se perd, il se retrouve. Il n’est pas défini par des frontières fixes, mais par une relation, une dynamique d’alliance qui l’appelle sans cesse à s’ouvrir et à se renouveler. Mais nous sommes aussi peuple en nous-mêmes. Notre être est habité par des voix, des parts multiples qui parfois s’opposent, s’ignorent, se dispersent. Ces parts, comme un peuple intérieur, sont appelées au dialogue, à l’unification, à devenir un espace habitable où l’Unité peut émerger. "Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, Je Suis est au milieu d’eux." (Matthieu 18,20). Cette parole s’accomplit aussi en nous : lorsque nos parts fragmentées cessent de lutter et s’accordent dans un même Souffle, le Je Suis peut se révéler en nous. Être peuple, c’est donc à la fois reconnaître notre lien profond avec les autres et apprendre à faire l’unité en soi. C’est laisser émerger cette Présence qui se tient au centre, lorsque tout en nous cesse de se disperser et s’incline vers l’Essentiel.
- peuple de Dieu Le peuple de Dieu n’est pas un groupe exclusif, séparé du reste de l’humanité. Ce n’est pas une appartenance ethnique, religieuse ou culturelle, mais une réalité intérieure. Être "peuple de Dieu", c’est reconnaître que l’on appartient à une histoire plus grande que soi. Ce n’est pas un privilège, mais un appel à vivre en relation, à ne plus s’identifier à un "moi" isolé, mais à marcher ensemble vers l’Ouvert.
- peur La peur est une contraction, un mouvement de repli face à l’inconnu, à la perte de contrôle, à ce qui menace l’identité ou la sécurité. Elle est une réaction naturelle, mais elle devient un piège lorsqu’elle nous enferme, nous empêche de vivre pleinement, nous fait voir le monde à travers le prisme du danger plutôt que de l’ouverture. Dans la Bible, l’appel le plus répété est : "N’aie pas peur." Ce n’est pas une injonction à nier la peur, mais une invitation à ne pas s’y soumettre. La peur est là, mais elle n’est pas un mur infranchissable – elle est un seuil, un lieu où tout peut basculer : vers l’enfermement si nous nous y accrochons, vers la liberté si nous osons la traverser. Jésus marche sur les eaux au milieu de la tempête et dit : "C’est moi, n’ayez pas peur." (Jean 6,20). La peur survient lorsque nous nous croyons séparé-e-s, isolé-e-s face aux éléments. Mais si nous reconnaissons l’Infini au cœur même de la tempête, alors la peur se transforme : elle devient un passage, un appel à oser avancer malgré l’incertitude. La peur n’est pas un ennemi, elle est une porte. Soit nous la fuyons et elle nous poursuit, soit nous la regardons en face et elle révèle son vrai visage : non un obstacle, mais un seuil vers une plus grande liberté.
- pharaon Pharaon, dans la Bible, n’est pas seulement un roi d’Égypte. Il incarne toute forme de pouvoir qui enferme, qui asservit, qui empêche la Vie de circuler librement. Mais Pharaon n’est pas qu’un personnage extérieur : il est aussi en nous. Il représente le mental qui veut tout contrôler, qui résiste au changement, qui refuse de lâcher prise. Il est cette part de nous qui s’agrippe aux habitudes, aux peurs, aux illusions de maîtrise, et qui durcit son cœur à chaque appel de l’Essentiel. L’Exode est un chemin intérieur. Nous devons tous et toutes, un jour, affronter notre Pharaon intérieur : ce qui en nous s’oppose à la liberté, ce qui refuse de laisser partir ce qui doit s’en aller. Mais l’Infini ouvre toujours une mer à traverser, pour ceux et celles qui osent avancer.
- Pharisiens Les Pharisiens sont, dans les Évangiles, des figures ambivalentes. Gardiens de la Loi, soucieux de fidélité à la tradition, ils incarnent une quête sincère de justesse spirituelle. Mais leur attachement aux règles peut devenir un piège : quand la forme prend le dessus sur le souffle, la fidélité devient rigidité, et la loi, enfermement. Jésus ne les rejette pas en bloc, mais il les interpelle avec force : "Vous filtrez le moucheron et avalez le chameau !" (Matthieu 23,24). Il ne critique pas leur pratique, mais leur tendance à s’attacher aux détails tout en oubliant l’essentiel : la justice, la miséricorde, la Présence vivante. Mais les Pharisiens ne sont pas seulement des personnages du passé, ni des "autres" à juger. Ils sont aussi en nous, chaque fois que nous nous accrochons à une règle, à une habitude, à une croyance, sans laisser place au Souffle. Chaque fois que nous voulons maîtriser le chemin spirituel plutôt que nous laisser transformer par lui. En nous, le Pharisien est cette part qui veut bien faire, mais qui se fige, qui cherche à contrôler au lieu d’accueillir, qui juge plutôt qu’elle ne s’ouvre. Il est aussi notre besoin de reconnaissance, notre attachement à une image de nous-même conforme aux attentes extérieures. Pourtant, tout Pharisaïsme peut être traversé. Nicodème, un Pharisien, vient voir Jésus de nuit, en quête d’autre chose (Jean 3,1-21). Le problème n’est pas la loi, mais la fermeture. Là où il y a écoute, remise en question, ouverture au Souffle, le Pharisien en nous peut lui aussi renaître d’en haut.
- Philippe Philippe est le disciple de la raison et du questionnement. Il est celui qui cherche à comprendre, à voir clairement. Quand Jésus dit "Je suis le chemin", Philippe demande : "Montre-nous le Père, et cela nous suffit." (Jean 14,8). Il veut une réponse tangible, une certitude visible. Il est cette part en nous qui veut des preuves, des repères solides, des explications tangibles. Il représente notre besoin de comprendre avant de nous ouvrir. Mais la réponse qu’il reçoit est un appel à voir autrement : "Celui qui m’a vu a vu le Père." (Jean 14,9). L’Essentiel est déjà là, il suffit d’un regard neuf pour le reconnaître. Philippe incarne la part en nous de la quête intellectuelle qui, lorsqu’elle lâche prise, peut s’ouvrir à une vérité plus grande que le mental.
- Pierre Pierre (Simon-Pierre) est celui qui vacille et qui tient, celui qui doute et qui ose. Son nom signifie roc, et pourtant il trébuche souvent. Il est l’image du chemin intérieur : celui qui cherche la vérité, qui chute, mais qui se relève toujours. Il est le disciple du paradoxe : capable d’affirmer "Tu es le Christ" et, peu après, de renier son maître. Jésus ne le choisit pas pour sa perfection, mais pour son cœur ardent, pour cette force en lui qui, malgré ses failles, ne cesse d’aimer. Pierre, c’est une part de nous qui nous oscille entre la peur et la confiance, entre l’égo et l’abandon. Mais celle qui, après ses errances, devient un roc, non par sa propre force, mais par l’Ouvert qui agit à travers elle.
- pitié La pitié, dans son sens courant, évoque un regard condescendant, un sentiment de supériorité face à la souffrance d’un autre. Mais dans la Bible, la pitié est souvent synonyme de miséricorde, d’une compassion qui vient du cœur et qui reconnaît l’autre dans son humanité. Avoir pitié, ce n’est pas se poser au-dessus de l’autre, mais se laisser toucher, être vulnérable avec lui-elle. Ce n’est pas voir l’autre comme un être diminué, mais comme un être vivant, traversant une épreuve qui pourrait être la nôtre. La vraie pitié n’écrase pas, elle relève.
- poisson Le poisson est insaisissable. Il apparaît puis disparaît, file dans les profondeurs, vit dans ce qui échappe au regard, à la parole, au contrôle. Dans les Évangiles, il surgit souvent là où l’on ne s’y attend pas : dans les paniers du partage, dans le filet du large, ou encore grillé au petit matin sur le rivage du Ressuscité. Très tôt, il devient symbole discret du Christ, sous la forme du mot grec ichthus, qui contient une confession de foi codée. Mais ce n’est pas un emblème triomphant : c’est un signe discret, humble, glissant comme un secret entre les vagues. En nous, le poisson est ce qui vit dans les eaux profondes de notre intériorité, ce qui échappe à la pensée linéaire et pourtant nous habite puissamment. Il nage dans les courants du Souffle, là où naissent les élans sans forme, les intuitions sans mots. Le rencontrer, c’est accueillir ce qui remonte des profondeurs du silence, ce qui cherche à se dire autrement. C’est aussi renoncer à pêcher par avidité, et apprendre à attendre, à écouter, à se rendre disponible. Pêcher des poissons, dans les Évangiles, c’est aider à faire émerger ce qui était caché, en soi comme chez les autres. Et si parfois le poisson se fait farceur — surtout au 1er avril — c’est peut-être pour nous rappeler, avec tendresse, de ne pas trop nous prendre au sérieux dans notre quête spirituelle. Il glisse entre les certitudes comme pour nous dire : l’Essentiel ne se laisse jamais attraper. Il se laisse suivre. Le poisson est souple, mouvant, libre, et c’est sans doute pour cela qu’il nous apprend à nager dans l’Ouvert.
- prêtre Le prêtre, dans la tradition biblique, est celui qui sert d’intermédiaire entre l’humain et le sacré, qui veille sur les rites et porte l’offrande du peuple. Il est le garant d’un lien, mais ce lien peut devenir une frontière. Dans la parabole du Bon Samaritain (Luc 10,25-37), le prêtre voit l’homme blessé… et passe à distance. Pris entre sa fonction et l’appel du vivant, il choisit la séparation plutôt que la relation. En nous, le prêtre représente cette part qui cherche à honorer l’Essentiel, mais qui peut s’attacher aux formes plus qu’à la vie. Il est la tendance à sacraliser certains espaces tout en en excluant d’autres, à vouloir relier sans toujours voir que l’Infini est déjà là, au-delà des cadres établis. Mais le prêtre en nous peut aussi s’ouvrir. Il peut devenir passeur, non plus gardien d’un seuil, mais témoin d’une Présence déjà donnée. Lorsque la séparation se dissout, il devient canal, non plus pour diviser le sacré et le profane, mais pour laisser circuler la Vie en tout.
- prière La prière n’est pas d’abord une demande à formuler ni une forme à bien suivre. Elle est un espace intérieur qui s’ouvre, une disponibilité à l’amour, une reliance silencieuse — à soi, à l’autre, à l’Essentiel. Elle peut commencer par des mots : une formule connue, un cri du cœur, un simple « aide-moi » ou « merci ». Mais elle peut aussi ne plus avoir besoin de paroles : devenir souffle, écoute, offrande intérieure. Dans la Bible, prier signifie souvent se tourner vers, s’ouvrir, offrir un élan du cœur. Dans cette perspective, prier n’est pas parler à un Dieu lointain, mais laisser la Présence nous habiter, laisser l’Essentiel prier en nous. Dans la non-dualité, la prière devient mouvement d’amour et de transformation, passage de ma volonté à une volonté plus vaste, chemin d’unité. Prier, c’est se relier. C’est aimer. C’est laisser l’Amour nous respirer. Et parfois, simplement… être là. -> voir aussi méditation Lire plus...
- promesse Une promesse biblique n’est pas un contrat, ni une garantie de succès futur. Elle est une ouverture, un appel à la confiance. La promesse de l’Infini ne se réalise pas comme un plan préétabli, elle se dévoile dans le mouvement de la Vie. Elle ne dit pas "tu recevras ceci", mais "ouvre-toi, et tu verras".
- prophète Le prophète n’est pas un devin qui prédit l’avenir, ni un maître qui impose une vérité. Il est un écoutant, un veilleur, un témoin de l’Essentiel. Il ne parle pas de lui-même, mais laisse une parole plus vaste le traverser. Dans la Bible, les prophètes sont souvent des figures dérangeantes. Ils ne confirment pas les certitudes, ils les bousculent. Ils rappellent ce qui compte, là où tout s’égare. "Un feu brûle en moi, je ne peux pas le contenir." (Jérémie 20,9) – Être prophète, c’est être habité par une parole qui dépasse celui ou celle qui la porte. Mais le prophète n’est pas un surhumain. Il doute, il résiste, il fuit parfois, comme Jonas qui refuse l’appel. Pourtant, il ne peut pas ne pas répondre, car sa parole n’est pas de lui. Il ne parle pas pour plaire, mais pour éveiller. En nous, le prophète est cette part qui sent quand quelque chose sonne faux, qui ne peut se taire face à l’injustice, qui appelle à revenir à l’Essentiel. Il n’est pas toujours entendu, mais il est celui ou celle qui veille, qui rappelle que l’Infini parle, encore et toujours, à qui sait écouter.
- puissance La puissance dont parlent les Écritures n’a rien à voir avec la domination ou la force imposée. L’Infini ne se manifeste pas dans le contrôle ou la contrainte, mais dans la subtilité d’un souffle, dans la force tranquille d’un amour qui ne s’impose jamais. La vraie puissance n’écrase pas, elle relève. Elle n’éblouit pas, elle éclaire doucement. Elle n’est pas dans le spectaculaire, mais dans l’invisible, dans la capacité d’ouvrir un espace où la Vie circule librement. Dans la tradition biblique, la puissance s’exprime paradoxalement à travers la faiblesse. Comme le dit Paul : "Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse." (2 Corinthiens 12,9). Ce n’est pas dans la toute-puissance humaine que l’Essentiel se révèle, mais dans l’abandon, la vulnérabilité, l’espace où l’égo lâche prise. C’est là que l’infini peut se donner sans résistance.
- puits Ce n’est pas la source. Ce n’est pas l’eau. Et pourtant, sans lui, pas d’accès à la profondeur. Le puits est passage. Lieu de reliance entre le visible et l’invisible, entre la surface agitée du quotidien et la Source silencieuse qui coule en secret. En nous, il peut être enfoui, oublié, bouché par les gravats de la peur, de l’oubli ou des blessures anciennes. Creuser un puits, c’est dégager ce qui entrave l’élan du Vivant. C’est descendre au-delà du bruit et des distractions, pour rejoindre l’eau vive qui a toujours été là, disponible, patiente. Dans la Bible, le puits est souvent un lieu de rencontre : avec l’autre, avec soi-même, avec l’Essentiel. Jacob y rencontre Rachel, Moïse y trouve refuge, Jésus y parle à la Samaritaine. Mais plus profondément, il est ce lieu intérieur où la soif s’avoue, où l’attente devient écoute, où le manque ouvre un chemin vers la Plénitude. Le puits en nous n’a pas besoin d’être inventé : il est là, creusé depuis toujours. Il suffit parfois d’oser s’arrêter, de retirer une pierre, de descendre doucement. Comme l’écrit Etty Hillesum : « Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. » Le puits n’est pas un lieu à conquérir, mais un espace à retrouver.
- pureté La pureté ne consiste pas à éviter certaines actions ou pensées considérées comme impures. Elle est transparence, clarté intérieure. Être pur, ce n’est pas être parfait selon des critères extérieurs, mais être sans double-jeu, être pleinement soi, aligné-e avec ce qui est vrai.