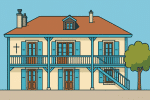Peut-on vraiment dé-finir l’Infini, si définir signifie lui mettre une limite ?

Ce lexique est vivant, en perpétuelle évolution. Il se transforme au fil de vos questions et de la recherche commune à la Maison bleu ciel.
Les définitions proposées ici ne sont pas des vérités figées, mais des pistes, des invitations à explorer, à questionner, à reformuler. Provisoires, elles ouvrent un chemin, offrent des repères sans enfermer.
Dans le domaine spirituel, les mots balbutient souvent. Ils ne sont que des éclats, des tentatives imparfaites pour pointer vers l’Indicible. Et au fil du temps, ils ont accumulé des couches, des interprétations, des rigidités qui les éloignent de leur source vive.
Les mots doivent être lavés pour retrouver leur limpidité. Ils ne prennent leur véritable sens que lorsqu’ils sont réaccordés à l’expérience, à la présence, à la résonance intime avec l’Essentiel. Ici, nous ne cherchons pas tant à les définir qu’à les laisser respirer à nouveau, à les délester de ce qui les alourdit pour qu’ils puissent redevenir ce qu’ils sont : des portes ouvertes vers l’Infini.
Tout le lexique

r
- rabbin Le rabbin est un maître de la Torah, un guide spirituel qui enseigne et interprète les Écritures dans la tradition juive. Il n’est pas un prêtre, mais un passeur, un médiateur entre le texte et la vie, entre la lettre et l’esprit. Dans les Évangiles, Jésus est souvent appelé Rabbi (Maître). Non parce qu’il serait simplement un enseignant, mais parce qu’il incarne une parole vivante, une lecture qui ouvre et libère. Il ne récite pas la loi, il l’accomplit en la réinterprétant sans cesse depuis l’Essentiel. En nous, le rabbin est cette part qui cherche à comprendre, à transmettre, à relier la sagesse ancienne à la réalité du présent. Il représente l’intelligence en quête de sens, mais aussi le risque de rester dans l’étude sans entrer dans l’expérience. Lorsque la connaissance devient vivante, lorsque l’enseignement ne se limite plus aux mots mais s’incarne dans l’existence, le rabbin devient témoin : non plus un gardien du savoir, mais un passeur de Vie.
- Rachel Rachel est celle qui est aimée dès le premier regard, celle pour qui Jacob travaille sept ans, qui lui paraissent "quelques jours, tant il l’aimait" (Genèse 29,20). Mais elle est aussi celle qui traverse l’attente et la souffrance, qui porte en elle un désir inassouvi avant d’enfanter. Son nom signifie peut-être "brebis", image de douceur et de vulnérabilité. Pourtant, sa vie est marquée par la rivalité, la stérilité, l’épreuve du manque. Elle voit sa sœur Léa enfanter facilement tandis qu’elle-même demeure sans enfant. Dans sa douleur, elle crie à Jacob : "Donne-moi des fils, sinon je meurs !" (Genèse 30,1). Mais la fécondité ne se maîtrise pas. Lorsqu’enfin elle enfante Joseph, son premier fils, elle prononce un nom qui signifie "qu’il ajoute", signe que son désir va toujours au-delà. Rachel meurt en donnant naissance à son second fils, Ben-Oni, "fils de ma douleur", que Jacob rebaptise Benjamin, "fils de la droite" (Genèse 35,18). Son départ est une traversée, une transformation : de la souffrance naît une bénédiction. En nous, Rachel est la part qui espère, qui désire, qui porte en elle un vide avant qu’il ne devienne plénitude. Elle est l’amour qui ne se possède pas, la fécondité qui naît du manque, le passage du cri à l’offrande.
- Rahab Rahab est une figure surprenante dans la Bible. Présentée comme une prostituée de Jéricho (Josué 2,1), elle est aussi celle qui ouvre un passage, qui protège et accueille, qui choisit la confiance plutôt que la peur. Lorsque les espions envoyés par Josué arrivent dans la ville, elle les cache et les aide à s’échapper. Elle ne s’accroche pas à l’ordre établi, elle sent que quelque chose de plus grand est en train d’advenir et elle choisit d’y participer. Rahab est celle qui voit autrement : alors que son peuple craint l’arrivée des Hébreux, elle reconnaît en eux un mouvement qui dépasse les frontières visibles. Elle ne se cramponne pas aux murailles de Jéricho, elle fait tomber d’abord en elle les murs de la séparation. Elle attache un fil rouge à sa fenêtre, signe de son engagement et de sa confiance. Ce fil devient un passage, un seuil entre destruction et salut, entre l’ancien qui s’effondre et le nouveau qui surgit. Rahab, loin d’être rejetée, entre dans la lignée de Jésus (Matthieu 1,5). Elle incarne la foi qui ne se limite pas aux appartenances extérieures, la confiance qui ose traverser l’inconnu, la femme qui fait tomber les murs en elle pour entrer dans un espace plus vaste. En nous, Rahab est cette part qui ose quitter les sécurités apparentes, qui ne s’accroche pas aux murs de l’ego mais choisit l’Ouvert. Elle est le courage d’accueillir ce qui vient, de se laisser traverser, de faire confiance à ce qui cherche à naître.
- Rameaux La fête des Rameaux célèbre l’entrée de Jésus à Jérusalem, acclamé par la foule qui dépose des rameaux sur son chemin. Elle ouvre la Semaine sainte, entre lumière et traversée. Dans une lecture intérieure, c’est le moment où le Vivant cherche à entrer au centre de notre être, humblement, porté non par la force mais par la simplicité. L’ânon devient symbole de ce qui en nous peut porter la Présence : une part encore libre, jamais exploitée, prête à servir l’Essentiel. Les rameaux, c’est ce que nous déposons pour laisser passer la Vie. Une fête de la joie fragile, de l’élan du cœur, de ce « oui » qui ouvre un chemin en nous. Mais en nous aussi, comme chez les pharisiens, des voix s’élèvent pour faire taire la joie, pour contenir l’élan, pour revenir au connu. Et ces foules intérieures, pleines d’enthousiasme aujourd’hui, peuvent aussi — demain — crier : « Crucifie-le ! » Car l’accueil du Vivant dérange. Il bouleverse nos attachements, nos illusions, notre pouvoir. La fête des Rameaux nous invite à reconnaître ces tensions en nous : l’accueil, la peur, la contradiction — et à choisir, en conscience, de laisser entrer la Présence, même fragile, même contestée.
- réconciliation Se réconcilier, ce n’est pas effacer le passé ni nier la souffrance. Ce n’est pas faire comme si rien ne s’était passé, mais accepter de voir autrement. La réconciliation véritable ne vient pas d’un effort mental, mais d’un retournement intérieur : une manière de regarder l’autre et soi-même avec un regard neuf, où l’Ouvert prend la place du repli.
- rédemption La rédemption n’est pas un rachat par un prix payé à un Dieu en colère. Ce n’est pas une dette effacée par une souffrance imposée. Être racheté-e, dans la tradition biblique, signifie être libéré-e de ce qui nous tenait captif-ve. Ce n’est pas un échange économique, mais un passage : sortir d’un état d’enfermement pour entrer dans la liberté d’être. Jésus ne nous "rachète" pas à quelqu’un, il nous ouvre un chemin intérieur : celui de la réconciliation avec l’Essentiel en nous.
- relatif Le relatif n’est pas l’opposé de l’absolu, mais son visage dans le temps. Ce n’est pas une illusion qu’il faudrait fuir pour atteindre une pureté spirituelle. Il est le lieu même où l’infini se laisse approcher : dans un regard, une rencontre, une fleur qui se fane, une joie qui passe. Le relatif est tout ce qui change, tout ce qui dépend de tout. C’est le domaine des formes, des liens, des histoires, des saisons. Il est le lieu de la relation, du mouvement, de la fragilité. Sans lui, rien ne se manifesterait, car c’est dans la limitation que la lumière se rend visible. Tomber amoureux du relatif, c’est aimer la vie dans sa forme et sa fragilité, sans chercher à la retenir ni à la purifier. C’est reconnaître que l’absolu se donne toujours à travers un visage, un instant, une matière, et que rien n’est trop petit pour le contenir. Ce n’est pas s’attacher à ce qui passe, mais consentir à ce qu’il nous révèle : l’unité qui s’incarne, la beauté du provisoire, la grâce de l’éphémère. Les Écritures en témoignent quand le Verbe se fait chair (Jean 1,14) : l’infini épouse la limite, le divin s’offre dans la poussière du monde. Aimer le relatif, c’est laisser l’absolu aimer à travers nous, jusque dans ce qui change et se défait, jusqu’à ce que tout devienne transparence de la Présence.
- reliance La reliance n’est pas l’appartenance à un groupe ni la sécurité d’un « nous » qui protège. L’appartenance naît du moi, de ce besoin légitime d’être reconnu, aimé, intégré. Elle procède de l’ego et, pour cela, reste toujours fragile : ce qui est acquis peut se perdre, ce qui rassemble peut aussi exclure. Elle donne une place, mais une place qu’il faut défendre. La reliance, elle, ne dépend pas de nos liens sociaux ni de notre sentiment d’être accepté·e. Elle procède de l’Unité avec la Source, du Je-suis qui précède toute appartenance et la fonde de l’intérieur. Elle ne se cherche pas, ne s’acquiert pas : elle se reconnaît. Elle a toujours été là et le restera toujours, comme un fond d’être qui ne se défait pas. Vivre la reliance, c’est revenir à ce lieu en soi où tout est déjà relié : à soi, aux autres, au vivant et à l’Au-delà de tout. Là, plus besoin de prouver qu’on appartient ; il suffit de se souvenir que nous sommes, depuis toujours et pour toujours, porté·es par le même Souffle. Comme le montre Yeshoua, entouré du cercle de ses proches, lorsqu’il dit : « Voici ma mère et mes frères : quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère » (Marc 3,34-35). Cette parole ne parle pas d’appartenance, mais de reliance : une communion intérieure qui ne s’appuie pas sur les liens du sang ou du groupe, mais sur la reconnaissance d’un même Esprit vivant en chacun·e.
- religion La religion n’est pas d’abord un système de croyances ou un ensemble de rites figés. Son étymologie (religare, « relier », ou relegere, « recueillir avec soin ») évoque un mouvement qui cherche à reconnecter l’humain à plus vaste que lui. La spiritualité est un besoin fondamental, tout comme manger, boire ou se sentir en sécurité. Nous avons tous soif de sens, de lien, d’une profondeur qui traverse l’existence. La religion est une des réponses possibles à ce besoin, en proposant des formes, des pratiques, des récits, des rituels qui permettent d’inscrire ce lien dans la vie quotidienne. Lorsqu’elle est vivante, la religion est un passage, une trame qui soutient, transmet, oriente sans enfermer. Mais lorsqu’elle se fige en dogmes, en institutions rigides, en obligations déconnectées de l’expérience vivante, elle peut perdre son souffle et devenir un mur au lieu d’un passage. Une religion juste ne cherche pas à posséder la vérité, mais à créer un espace où chacun-e peut s’ouvrir à l’Essentiel, à sa manière. Elle est un cadre qui peut aider, mais qui ne doit jamais remplacer l’expérience intérieure.
- repentance La repentance ne signifie pas se lamenter sur ses fautes ou se sentir coupable. Ce mot, en grec biblique (metanoia), signifie littéralement "faire retour" ou "changer de regard". C’est une réorientation de l’être, un retournement intérieur qui nous reconnecte à ce qui est vivant et vrai. Ce n’est pas un acte de contrition, mais un passage vers plus vivant.
- résurrection La résurrection n’est pas seulement un événement du passé concernant Jésus. C’est un éveil, une ouverture, une façon de voir autrement avec un autre niveau de conscience. Mourir et renaître, ce n’est pas un processus réservé à un après-mort, c’est une expérience qui peut se vivre maintenant : sortir des enfermements de l’égo pour entrer dans un espace de vie plus vaste.
- révélation La révélation n’est pas un savoir caché que seul-e-s certain-e-s initié-e-s pourraient recevoir. C’est un dévoilement intérieur, une lumière qui se fait en nous lorsque nous sommes prêts à voir. Elle n’ajoute rien, elle rend visible ce qui a toujours été là. Synonyme: Apocalypse
- rituel du pain et du vin Ce rituel n’est pas une simple mémoire du passé, mais une invitation à nourrir le "Je-suis" en nous. Jésus l’institue pour nous rappeler ce que nous oublions sans cesse : notre identité profonde ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans le "Je-suis" qui nous habite et nous conduit au-delà de la vie que nous nous sommes construite. Nous avons besoin de signes pour en faire mémoire. Dans notre quotidien, nous sommes comme un puits bouché qui a oublié qu’il contenait la source. Ce repas est là pour creuser notre faim de Vie, réveiller en nous l’élan vers l’Essentiel. Le pain représente ses paroles : les mâcher, les méditer, les assimiler jusqu’à ce qu’elles deviennent vivantes en nous. Le vin est sa vie donnée : boire son sang, c’est entrer dans cette même ouverture du cœur, où il n’y a plus de séparation entre l’humain et l’Infini. Mais ce repas est aussi une question : de quoi avons-nous vraiment faim ? Au-delà de nos besoins terrestres, une faim plus essentielle nous habite : celle de la Présence, du Je-suis. Jésus dit : "Je suis le pain de vie." (Jean 6,35). Manger ce pain, boire ce vin, c’est laisser le Je-suis prendre chair en nous, devenir ce que nous recevons. Car la Vie ne s’accumule pas, elle circule, elle se donne.
- Royaume Le Royaume de Dieu (ou des cieux) n’est pas un territoire lointain ni un paradis après la mort. Il est déjà là, présent en nous, mais souvent voilé par nos illusions de séparation. Jésus le dit clairement : "Le Royaume est en vous." (Luc 17,21). Ce Royaume est l’espace du "Père" en nous, la dimension de l’Infini qui nous habite. Il n’est pas à conquérir, mais à reconnaître, à laisser émerger en nous. C’est le lieu de l’Unité, où l’égo s’efface pour laisser place au Je-suis vivant. Si le monde est l’espace du "Fils" – où l’Incarnation se déploie, où l’Infini prend corps dans la matière – alors le Royaume est ce qui soutient et traverse tout, la dimension invisible qui sous-tend chaque instant, chaque être, chaque relation. Il ne s’agit pas d’y entrer comme on franchit une porte, mais d’y consentir, de s’ouvrir à cette Présence qui circule déjà en nous et entre nous.